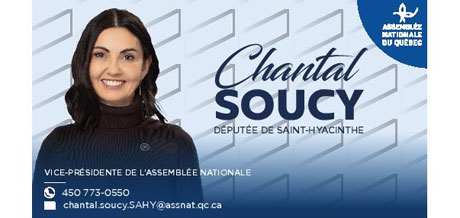Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
Notre organisme a pour but de vous faire découvrir et apprécier l’histoire de Saint-Hyacinthe et de la région. Les ressources de nos services d’archives et de généalogie sont à votre disposition pour vous aider dans la recherche de votre histoire personnelle ou de celle de votre milieu.
Dernières nouvelles
Quel événement en lien avec le patrimoine marque l’actualité? Soyez au courant des dernières nouvelles concernant l’histoire de Saint-Hyacinthe et de la région. De plus, retrouvez ici les publications les plus récentes et les activités à venir au Centre d’histoire.
- À la une, Nouvelles du Centre
La SDC centre-ville Saint-Hyacinthe et le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe vous invitent à découvrir le Parcours des incendies. Douze stations sont installées afin de vous permettre d’en apprendre davantage sur
- À la une, Nouvelles du Centre
Cordial bonjour à tous les membres du Centre d’histoire, Veuillez prendre note que la prochaine Assemblée générale annuelle des membres du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe Inc. aura lieu le mardi
- Uncategorized
Le mardi 7 mai 2024 à 19h00, au Centre culturel Humania Assurance, aura lieu la conférence « Les jouets au Québec 1939-1969 ». Jean Bouchard, collectionneur et auteur, mettra en
- À la une, Nouvelles du Centre
Le 8 avril prochain, si le temps le permet, nous pourrons assister à un phénomène plutôt rare: une éclipse totale du soleil. Cet événement aurait certainement plu à Mgr Charles-Philippe
Expositions virtuelles
Nos expositions virtuelles vous permettent d’explorer différents aspects de l’histoire de la région de Saint-Hyacinthe et de découvrir plusieurs documents textuels et photographiques faisant partie de notre collection.
Histoires d’ici
Cette rubrique vous propose plusieurs textes dont la plupart proviennent des chroniques historiques du Courrier de Saint-Hyacinthe. Certains articles ont également été rédigés pour être diffusés directement sur notre site. Ils traitent de divers aspects de l’histoire maskoutaine.
Généalogie
La généalogie est un service qui aide les chercheurs à explorer et à retracer leur histoire familiale, en remontant dans le temps pour découvrir leurs ancêtres et leur lignée. Elle est également une porte d’entrée vers l’histoire.
Abonnez-vous
Devenez membre du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe afin d’encourager la recherche et la diffusion de notre histoire régionale. Devenir membre c’est également favoriser un meilleur environnement pour le traitement et la conservation de nos fonds d’archives.
Faites un don
Votre don est important car il nous permet de soutenir l’ensemble de nos activités et il contribue à favoriser la recherche et la diffusion de l’histoire régionale de Saint-Hyacinthe par le biais, par exemple, de publications et d’expositions virtuelles.